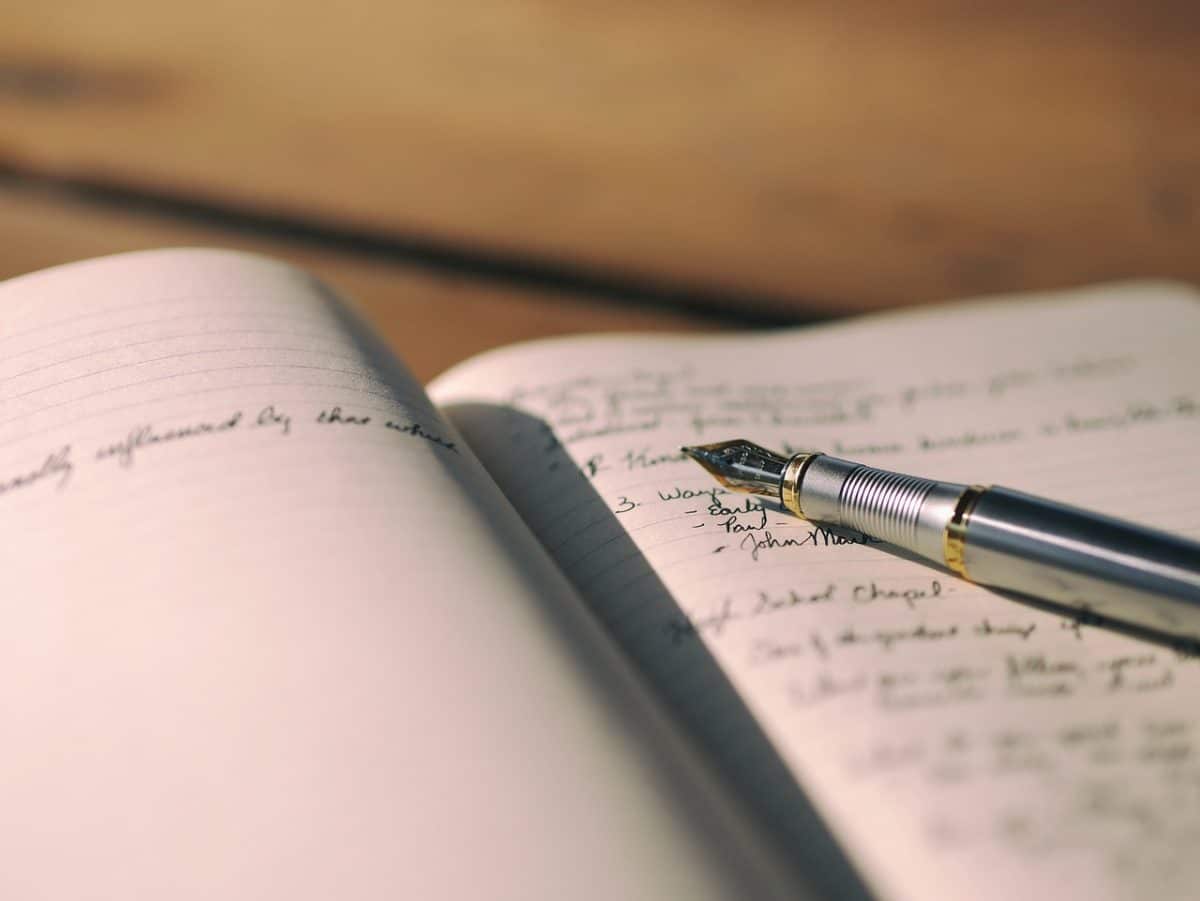En 2022, seulement 14 % des grandes maisons de couture étaient dirigées par des femmes, malgré une clientèle majoritairement féminine. Les codes vestimentaires imposés lors des défilés restent largement binaires, limitant la créativité des designers qui souhaitent explorer des expressions de genre plus fluides. Toutefois, certains labels émergents choisissent de contourner ces conventions, provoquant des réactions contrastées dans un secteur encore très normé.Les inégalités salariales persistent aussi bien dans les ateliers que dans les bureaux de création, alors que la main-d’œuvre est principalement féminine. Les initiatives pour rééquilibrer les rapports de pouvoir peinent à s’imposer face à des structures hiérarchiques traditionnelles.
Comment la mode façonne nos perceptions du genre
La mode ne se contente pas de recouvrir nos corps : elle trace, bien souvent en silence, les contours du masculin et du féminin. Dans les vitrines ou sur les podiums, les différences sautent aux yeux. La coupe d’un vêtement, une couleur, une manière de se tenir : autant de détails qui renforcent sans cesse la démarcation entre les genres. Le vêtement n’est pas seulement un habit, il devient manifeste. Celles et ceux qui, de Jean Paul Gaultier à de jeunes designers, osent sortir de la norme, bousculent le décor, mettent la binarité face à ses limites, et dessinent un autre horizon.
Aujourd’hui, ce sont les réseaux sociaux qui accélèrent ces basculements. On y voit émerger des codes inédits, chaque communauté bricole ses propres signes, invente de nouvelles façons de s’affirmer. Des hommes en jupe qui n’attendent plus qu’on les interpelle. Des femmes qui se fondent dans les codes du costume, trois-pièces compris. Les images circulent, s’entrecroisent, et la représentation du genre vacille, mais ne s’effondre jamais tout à fait. Tout bouge, et pourtant, les résistances s’accrochent.
Pour rendre compte de ces évolutions, plusieurs éléments retiennent l’attention :
- Le choix d’un vêtement raconte un chemin, traduit une intention, qu’on le veuille ou non, il expose un rapport de force social.
- Les collections vraiment mixtes restent rares dans la mode, malgré des discours de plus en plus inclusifs.
La mode, ce miroir piégé, façonne discrètement les attentes. Elle impose ses archétypes, tout en laissant parfois la place à des pistes nouvelles. Enfiler un vêtement, c’est reprendre un récit ou en écrire un inédit.
Entre stéréotypes et innovations : l’industrie face aux identités de genre
L’industrie de la mode avance avec précaution sur la question du genre. Les marques établies cloisonnent toujours leurs collections : l’univers des hommes d’un côté, celui des femmes de l’autre. Rien n’a bougé depuis des décennies. La fast fashion renforce ces clivages : des silhouettes familières, des campagnes publicitaires qui distribuent les vêtements à chacun selon son genre, et des rayons segmentés à l’extrême. Ce confort du connu a un prix : il perpétue des schémas qui enferment.
Mais une génération impatiente pousse. Elle réclame des collections gender-inclusive, une mode éthique, et une remise à plat des standards. Certains acteurs comme H&M testent des collections mixtes, brouillant la frontière des genres sur les étiquettes. L’élan existe, mais il reste discret. En 2023, un petit quart des marques internationales seulement proposaient des lignes véritablement inclusives, selon les études du secteur.
Pour mieux saisir ce qui limite ces avancées, quelques constats s’imposent :
- La fast fashion mise avant tout sur la performance commerciale et laisse de côté toute réelle prise de risque sur le plan social.
- La curiosité pour des vêtements non genrés gagne du terrain, mais l’offre demeure restreinte, portée par une poignée de projets isolés.
Dans les ateliers où les vêtements prennent forme, la frontière du genre se matérialise à chaque étape. Les pièces destinées au marché occidental obéissent à des standards bien ancrés. Les rares expérimentations ne dépassent souvent pas la petite série ou la collection capsule. Changer la donne à grande échelle demeure hors de portée pour la plupart des acteurs de l’industrie de la mode.
Pourquoi l’égalité de genre reste un défi dans les coulisses de la mode
Dans les usines textiles, la situation est claire : les femmes sont largement majoritaires à la production. Au Bangladesh comme au Pakistan, environ 80 % du personnel est féminin. Pourtant, les écarts de salaire sont courants. Le salaire minimum s’applique surtout aux femmes, qui perçoivent souvent moins que leurs collègues masculins à poste équivalent. Les postes de direction, quant à eux, restent verrouillés. Les hommes monopolisent le pouvoir, que ce soit au siège ou dans les ateliers, partout dans le monde.
L’accès aux responsabilités se heurte à une série d’obstacles. En France, on comptait, en 2023, seulement 12 % de femmes cadres dans les géants du secteur. Les salaires ne progressent pas toujours au même rythme selon le genre, même formation, même expérience à l’appui : les écarts subsistent, année après année.
Pour mieux comprendre les enjeux qui freinent la progression des femmes dans la filière, retenons deux faits majeurs :
- Le harcèlement sexuel s’ajoute à la précarité au travail. Dans plusieurs ateliers d’Asie du Sud, le silence domine et les recours sont faibles, parfois inexistants.
- Les conditions de travail des femmes, pourtant majoritaires dans la chaîne de production, restent largement occultées dans le débat public, même quand ONG ou syndicats s’investissent.
D’un bout à l’autre du secteur, la force de travail féminine fait tourner la machine. Et pourtant, cette réalité ne débouche que rarement sur des changements concrets. L’exigence de profit, l’urgence du renouvellement permanent des collections, tout semble conspirer pour maintenir l’ordre établi. Les progrès demeurent fragiles, parfois éphémères.
Vers des pratiques vestimentaires plus inclusives et responsables
La mode responsable prend le contre-pied de la fast fashion et vient bousculer la place du genre, mais aussi les habitudes de fabrication, le choix des matières et la visibilité du processus. De nouveaux labels indépendants, dans la lignée du slow fashion, tentent de sortir du cadre : collections non genrées, valorisation de l’artisanat, transparence sur l’origine des vêtements. Porté par des créatifs, des clients exigeants, et des organisations comme Oxfam, le secteur cherche à alerter sur l’envers social de la mode.
Ce mouvement reste dispersé, mais la dynamique est là. En France, plusieurs jeunes marques se démarquent en plaçant la question du genre au centre de leur engagement. Leur priorité : la traçabilité, la réduction de l’impact écologique, et une rémunération juste pour tous, femmes et hommes confondus.
Pour mieux distinguer ces démarches, voilà ce qui les caractérise :
- Les vêtements « genderless » invitent à repenser le rapport au corps, à la diversité, et à la singularité de chacun.
- La fabrication locale, en s’inscrivant dans la mode éthique, met en lumière les créatrices et offre plus d’espace aux minorités longtemps restées à l’écart.
Les attentes des acheteurs s’ajustent, elles aussi : l’origine des pièces, le respect des droits fondamentaux, et les réalités des ateliers de production entrent en jeu. L’innovation ne s’incarne plus dans la promesse marketing, mais dans la cohérence des idées, là où se croisent genre, écologie et justice sociale.
La mode ne se cantonne plus au suivi passif des tendances : elle façonne de nouveaux récits, pièce après pièce, pour que chacun y trouve, ou invente, sa place. Le vestiaire, demain, ressemblera-t-il enfin à celles et ceux qui l’animent ?